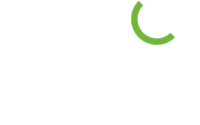Le projet FISHMIX s’étend sur trois territoires au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir la Dombes, l’Isère et la plaine du Forez. Porté par l’ISARA, il vise à répondre à trois questions centrales liées au maintien de la production piscicole dans les territoires d’étangs en région AURA.
Le projet a débuté en janvier 2023 et se terminera fin 2025.

Financeur : ce projet est financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes





Les étangs et paysages associés fournissent différents services écosystémiques, tels que la production de biomasse aquacole et la conservation de la biodiversité. La productivité biologique de l’étang est la principale ressource pour la réalisation de ces services. En pisciculture d’étang, cette productivité peut représenter jusqu’à 70% de la biomasse de poissons produites pendant un cycle d’élevage annuel. Certaines pratiques piscicoles telles que le chaulage (apport de chaux pour diminuer le pH des étangs et favoriser notamment la production de zooplancton), la fertilisation corrective et l’assec tous les 4 à 5 ans (mis à sec de l’étang) peuvent optimiser cette productivité. Toutefois, la mise en charge en poissons en début de saison peut parfois ne pas être adapté au potentiel biologique de l’étang, que ce soit au niveau quantitatif (densité de poissons) ou qualitatif (espèces de poissons utilisées). De plus, la pisciculture d’étangs doit s’adapter au contexte du changement climatique qui devrait s’intensifier rapidement dans la région AURA.
Le projet FISHMIX porté par l’ISARA, vise à répondre à trois questions centrales liées au maintien de la production piscicole dans les territoires d’étangs en région AURA:
- Quels seront les effets précis du changement climatique sur le fonctionnement des étangs dans notre région?
- Comment adapter l’alevinage des étangs en tenant compte du fait que certaines espèces produites ne sont (ou ne seront) plus vraiment adaptées aux conditions de milieu (brochet et sandre notamment) et que d’autres espèces plus rustiques peuvent arriver en substitution/addition dans l’assemblage d’espèces empoissonnées ?
- Comment adapter l’empoissonnage (en qualité et quantité) au potentiel de productivité de l’étang et aux risques encourus pendant la saison estivale ?
La réponse à ces questions est considérée comme un enjeu majeur pour les filières locales et permettra aussi de maintenir une surveillance sur les bilans hydrologiques et l’évolution des volumes d’eau disponibles, à l’échelle de l’étang et de la chaîne d’étangs.
De manière plus détaillés, le projet a quatre objectifs principaux :
- Définir des assemblages d’espèces résistant aux impacts du changement climatique
- Mieux adapter la stratégie d’alevinage à la productivité biologique de l’étang
- Assurer un revenu suffisant pour le pisciculteur
- Conserver la biodiversité établie
Matériels et méthodes
Le travail est organisé autour de cinq actions complémentaires à savoir :
- Mise en place d’outils de suivi long terme dans les zones étudiées
Cette étape consiste en l’installation d’appareils de mesure en continu (de l’oxygène, de la température et du niveau d’eau) sur 20 étangs expérimentaux. Il s’agira aussi de placer des stations météorologiques sur les différents territoires concernés en fonction du maillage territorial. Ces outils permettront de renseigner les variations spatio-temporelles des paramètres physiques caractérisant le mieux les impacts du changement climatique.
- Expérimentations de nouveaux assemblages de poissons en étang
Il s’agit ici de définir des assemblages d’espèces et des densités d’empoissonnage par espèces en se basant sur des connaissances scientifiques (compatibilité des espèces associées, niveau de production biologique théorique des étangs). Ces scénarios seront appliqués directement chez les producteurs engagés dans le projet pendant trois ans sur au moins 3 étangs par an (minimum 9 répétitions du même scénario)
- Suivi de la productivité naturelle et de la biodiversité des étangs expérimentaux
Les différents étangs concernés par les scénarios d’empoissonnage seront suivis au niveau hydrologique, physico-chimique, biologique et sédimentaire.
- Évaluation des résultats
En utilisant les données recueillies, une analyse comparative des différents scénarios sera effectuée en prenant en compte trois aspects : zootechnique, économique et écologique. Les convergences de ces trois types de bilans selon les scénarios appliqués seront également étudiées.
- Communication et transfert vers les partenaires professionnels et techniques
Résultats clés
Les résultats attendus du projet FISHMIX sont:
- Une meilleure connaissance du fonctionnement des étangs dans un nouveau contexte de pressions environnementales liées au changement climatique:
- la connaissance des variations intra-saisonnières et pluriannuelles du niveau d’eau, de la température de l’eau et de la teneur en oxygène dans les étangs de la région.
- la définition d’une typologie des étangs de la région AURA en fonction de leur productivité biologique en prenant en considération les dérèglements climatiques
- La construction et la validation de nouvelles options d’élevage :
- Proposer un panel de stratégies d’empoissonnage intégrant l’évolution attendue des conditions climatiques, avec notamment la définition d’assemblages adaptés à différents niveaux de fonctionnement et de productivité des étangs,
- Valider des assemblages par l’expérimentation sur un nombre élevé d’étangs (plan expérimental basé sur 20 étangs par an sur 3 ans). Cette validation sera basée sur des critères liés à la zootechnie, au bilan économique de l’activité piscicole, et au bilan concernant la productivité biologique et la biodiversité associée aux étangs étudiés.
- L’assec est une période pendant laquelle un étang n’a plus d’eau (Bernard Bachasson · 2012). L´assec peut être soit naturel dû au fonctionnement cyclique normal des étangs soit artificiel (assec de pêche ou assec de gestion).
- L’alevinage désigne le peuplement ou le repeuplement des eaux douces en alevins, par l’homme en vue de la pêche ou de la pisciculture.(www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alevinage/2191)
- La Dombes est un plateau d’origine glaciaire situé dans l’Ain et était considéré comme une zone humide inculte. Au Moyen-âge, les moines locaux ont initié la construction d’étangs pour rendre les terres cultivables et ils ont utilisés ces étangs pour produire une protéine nouvelle pour les habitants : le poisson. Aujourd’hui, on compte environ 1200 étangs (11000 hectares d’eau) connectés en chaînes, avec toujours une production locale significative de poissons tels que la carpe, le gardon, le rotengle, le brochet, la tanche. La production est d’environ 1000 tonnes par an, avec le maintien des us et coutumes concernant les droits d’usage de l’eau et les pratiques de gestion des étangs. Avec le changement climatique qui s’intensifie, le territoire est soumis à plusieurs contraintes remettant en cause à terme la pisciculture : manque d’eau, conditions physiques défavorables à certaines espèces. L’objectif est donc de travailler sur les points permettant une certaine résilience de ce système de production.
Équipe projet
Joël Robin (référent projet), Soraya Rouifed, Mathieu Guérin, Léo Girard, Benoit Sarrazin, Sylvie Prestoz, Alexander Wezel.
Partenaires
APPED (Association pour la Promotion du Poisson d’Étang de Dombes), ADAPRA (Association pour le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche en Auvergne-Rhône-Alpes), UR AFPA Université de Nancy, UMR SAS INRAE Rennes, ITAVI Rouen
Ressources et publications
Aubin Joël, Robin Joël, Wezel Alexander, Thomas Marielle. Agroecological Management in Fish Pond Systems. 2017. https://isara.hal.science/hal-03672954v1
Wezel Alexander. Agroecological practices for sustainable agriculture: principles, applications, and making the transition, World Scientific, pp.355-394, 2017, 978-1-78634-305-5